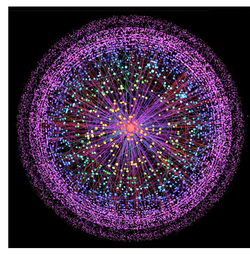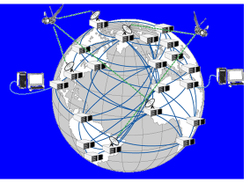«
La face noire de l’Italie» : c’est le titre d’une remarquable analyse signée
Jacqueline Risset, parue le 27 février dans
Le Monde.fr. Je ne saurais trop recommander cet article à tous ceux qui ont aimé ce pays, et peut-être l’aiment encore, sans savoir que l’objet de leur amour est -et a toujours été- une illusion, une carte postale enchanteresse qui cachait une réalité bien différente.
J’ai vécu 25 ans en Italie où je suis arrivée à la fin des années soixante, cornaquée par un beau fiancé du cru. Comme tout étranger qui découvre pour la première fois le
pays où les citronniers fleurissent, je suis immédiatement tombée sous le charme. On était en plein
miracolo economico et les Italiens s’en donnaient à cœur joie. Oubliés les vingt ans de fascisme, oubliée la misère d’après-guerre, on ne pensait qu’à bien manger, bien boire, parader en Alfa Romeo décapotable,
fare l’amore. J’avais vingt ans: l’Italie, sa langue si musicale, ses habitants si sympathiques et son mode de vie si hédoniste... tout me ravissait.
Puis vinrent les années 70 et le début de la «stratégie de la tension», des attentats, du terrorisme.
Les années de plomb. À chaque nouvel attentat, on accusait d’abord l’extrême-gauche, ensuite l'extrême-droite. À longueur de pages, les journaux glosaient sur les «extrémismes opposés» et tout était très confus. Le pays a frôlé la guerre civile mais nous, jeunes Milanais en début de carrière dans la capitale de la mode, du
design et de l’édition, étions bien trop occupés pour nous inquiéter vraiment. À part ceux qui avaient rallié les groupuscules de la gauche "extra-parlementaire" et se prenaient terriblement au sérieux, nous n’avons jamais compris à quel point la situation était grave. L’Italie est un pays qui vit à la surface des choses.
Entre une bombe et l’autre, un assassinat politique et l’autre, la vie continuait, dans une alternance de week-ends à la neige, réunions féministes, dîners au restaurant et manifs monstres en centre-ville… Nous descendions tous dans la rue car nous étions tous «de gauche». Politiquement corrects avant la lettre, nous ne lisions que les «bons» journaux et les «bons» livres, n’allions voir que les «bons» films. Tout cela n’était qu’une pose, mais nous ne nous en rendions pas compte. L’Italie est un pays qui vit à la surface des choses.
Puis petit à petit, de façon imperceptible, les choses se sont mises à changer. Un entrepreneur immobilier milanais a envahi les foyers de la péninsule entière avec ses chaînes de télévision et leur cohorte de gros seins, talons aiguille et lèvres gonflées, qui faisaient la nique aux féministes et à leurs sacro-saintes revendications. Le cinéma a suivi et s’est mis à rivaliser de vulgarité avec les chaînes berlusconiennes. Les kiosques ont été submergés de magazines
people, plus triviaux les uns que les autres. Une lame de fond a peu à peu recouvert le pays. Mais les Italiens n’ont rien vu venir. Outre à la mémoire courte, les Italiens ont la vue basse.
 Poursuivi par la justice pour des affaires de corruption, le constructeur véreux s’est lancé dans la politique pour échapper à la prison. Il disposait d’un outil de propagande imbattable: ses chaînes de télévision. Désormais dépendante des starlettes en strass et paillettes et des JT pour décérébrés, la population n’y a vu que du feu et l’a suivi avec enthousiasme.
Poursuivi par la justice pour des affaires de corruption, le constructeur véreux s’est lancé dans la politique pour échapper à la prison. Il disposait d’un outil de propagande imbattable: ses chaînes de télévision. Désormais dépendante des starlettes en strass et paillettes et des JT pour décérébrés, la population n’y a vu que du feu et l’a suivi avec enthousiasme.
Mais où étaient donc passés les intellectuels engagés, qu’étaient devenus les combats des femmes, où se cachait toute cette bourgeoisie cultivée et -bien sûr- «de gauche» au sein de laquelle j’avais vécu? S'était-elle immolée dans un gigantesque autodafé? Que nenni. Plutôt que de regarder en face la réalité ambiante et se donner les moyens de résister au tsunami berlusconien, les Italiens éduqués et civilisés ont choisi le suicide de la conscience: ne rien voir, ne rien entendre et surtout ne rien dire. L'Italie ne vit plus à la surface des choses, elle a sombré dans la narcose collective: plus de la moitié du pays, droguée aux télévisions, continue à croire en Berlusconi et à le trouver simpatico quoi qu’il fasse. Les autres dorment d’un sommeil de plomb.
À mon arrivée en France en 1993, j’ai essayé de raconter l’Italie et ce qui s'y passait: Berlusconi allait immanquablement se faire élire, le pays allait devenir invivable, envahi par l’arrogance, l’inculture et la vulgarité d’une nouvelle classe dirigeante dont la seule religion était l’argent. Mais personne ne voulait m’écouter: qui étais-je pour parler aussi mal d’un tel paradis? Les Français, comme tous les autres, tenaient à préserver leur image rêvée du "
pays où les citronniers fleurissent", un pays qui n’existe pas. J'ai compris que j’agaçais et n'ai plus abordé le sujet.
Dix-sept ans après, les médias commencent à s’apercevoir de la gravité de la situation et la vérité de l’Italie apparaît au grand jour. Mieux vaut tard que jamais.
Illustrations: "Goethe dans la campagne romaine", par J.H.W. Tischbein; une rue de Naples